Thème : Doctorat
Soutenance de thèse de Laure PIZZELLA
Prise en compte d'une anisotropie variable en modélisation géologique 3D par la méthode implicite du potentiel : application aux structures plissée
Résumé de la thèse en français
Les méthodes de modélisation géologique 3D ont pour but de construire des modèles numériques cohérents du sous-sol à partir de données ponctuelles échantillonnées sur le terrain ou en profondeur. Très populaires de nos jours, les méthodes dites implicites permettent de construire plusieurs champs scalaires agencés les uns par rapport aux autres et construits à partir de données de contacts d'unités géologiques et de leurs orientations respectives. Les surfaces géologiques sont ensuite extraites comme iso-potentielles de ces champs. Dans ce cadre, la Méthode du Potentiel, proposée il y a plus de 20 ans par l'École des Mines et le BRGM, utilise les outils géostatistiques, comme l'interpolation par co-krigeage, afin de reconstruire ces champs scalaires et ces surfaces. Bien qu'éprouvées, ces méthodes de modélisation montrent encore leurs limites face à quelques modèles complexes. Certaines structures géologiques, telles que les plis non cylindriques, les filons minéralisés ou les réseaux fluviatiles par exemple, présentent une structuration suivant une direction préférentielle (anisotropie) clairement identifiable localement mais variant spatialement. Très souvent, le nombre ou la répartition des données disponibles initialement ne permet pas de caractériser cette anisotropie variable correctement. Ces travaux de thèse visent à pallier ce manque en intégrant cette anisotropie comme donnée d'entrée au sein de la modélisation. Pour ce faire, deux approches ont été développées : (1) Une première approche exploite les données de dérivées premières (tangentes) ou dérivées secondes du champ de potentiel, permettant de contraindre localement l'anisotropie du champ scalaire. Cette approche est développée dans le cadre de la modélisation de plis poly-phasés, exemple emblématique de la problématique de l'anisotropie variable et de la nécessité d'action sur la courbure de surfaces. L'apport et l'usage de chacun des types de données sont comparés et discutés dans ce cadre. (2) Une seconde approche plus globale interprète le potentiel comme la convolution d'un bruit blanc par un noyau gaussien. Cette méthode permet d'introduire une expression de l'anisotropie sous forme explicite, pouvant être interpolée depuis des données d'anisotropie échantillonnées ou construite comme un a priori géologique. Enfin, le contexte de déploiement respectif de l'une ou l'autre approche développée est discuté en regard du cas d'application considéré.
Résumé de la thèse en anglais
Three-dimensional geological modelling methods aim at building relevant and coherent underground numerical models based on field-collected data. So-called implicit methods, which have been increasingly used, allow to construct a potential field from contact and orientation data of observed geological units. These numerical models allow to extract isopotential surfaces and interpret them as geological surfaces. In this framework, the “Potential Field Method”, introduced over 20 years ago by MINES ParisTech and BRGM, use geostatistical tools, like the means of co-kriging interpolation, to construct these potential fields. Despite having been extensively used, these modelling methods still exhibit some limitations when confronted to complex models. Non-cylindrical folds, mineralized veins or channel networks, among other geological structures, present a clearly identifiable and spatially variable preferential orientation, called anisotropy. Often, the amount and/or spatial distribution of available data do not allow a unique and accurate representation of the variable anisotropy. This PhD work aims at overcoming these limitations through the integration of anisotropy data as an input to the implicit method. Two approaches have been developed and studied: (1) A first approach takes advantage of first or second derivative data to locally constrain the anisotropy of the potential field. This approach was developed in the framework of polyphase foldings, an iconic example of the variable anisotropy problematic due to its inherent requirement of surface curvature constraints. For this approach, benefits of different input data are compared. (2) A second approach suggests to interpret the potential field as the convolution between a white noise and a gaussian kernel. This allows to mathematically and explicitly describe the anisotropy properties, which can either be interpolated from sampled data or built based on geologist's interpretation. Finally, applications of either methods are compared and their respective advantages and drawbacks, in regard of the target applications, are discussed.
Titre anglais : Accounting for variable anisotropy in 3D geological modeling with the implicit potential-field method : application to folded structures
Date de soutenance : vendredi 11 décembre 2020 à 9h00
Adresse de soutenance : MINES ParisTech Fontainebleau ou Paris – A déterminer
Directeurs de thèse : Jacques RIVOIRARD, Gabriel COURRIOUX
 En savoir plus
En savoir plus
Soutenance de thèse de Léo SZEWCZYK
Remplissage de chenaux abandonnés par la charge de fond
Résumé de la thèse en français
Les dépôts grossiers de remplissage de chenal abandonné sont étudiés à partir de modèles analogiques et d'exemples de terrain. Un modèle détaillé de leur architecture est proposé et les facteurs contrôlant leur formation sont identifiés dans les expériences. Des effets hydrauliques liés à l'asymétrie et à l'angle de diversion de la bifurcation contrôlent le dépôt des sédiments grossiers ainsi que leur extension. Ces relations sont quantifiées pour la première fois. L'influence du niveau de base, de la longueur ou pente du chenal abandonné sont discutés. Les études de terrain montrent que l'architecture des dépôts grossiers peut être préservée sur le long terme et que la relation expérimentale prédit la longueur minimale des dépôts grossiers formant le bouchon de chenal.
Résumé de la thèse en anglais
Abandoned channels coarse-grained fill deposits are studied using flume experiments and field surveys. A detailed model of the channel plug architecture is proposed, and controls on its formation identified from flume experiments. Hydraulic effects, controlled by the asymmetry and diversion angle of the bifurcation, determine the sedimentation pattern and extent of the bedload deposits in abandoned channels. These relationships are quantified for the first time. Influence of base level, abandoned channel length or slope is discussed. Field surveys of abandoned channels demonstrate that the bedload channel fill architecture can be preserved in time and that the experimental relationship is reliable to predict the channel plug coarse deposits minimal extent.
Titre anglais : Bedload fill of abandoned channels
Date de soutenance : vendredi 18 décembre 2020 à 14h00
Adresse de soutenance : MINES ParisTech 35 Rue Saint Honoré 77300 Fontainebleau – visioconférence
Directeurs de thèse : Isabelle COJAN, Jean-Louis GRIMAUD
 En savoir plus
En savoir plus
Mike Pereira, docteur MINES ParisTech, sur le podium !
En finale du prix de thèse de l'AMIES pour ses travaux en géostatistique
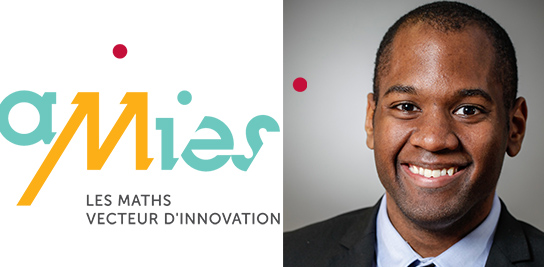
Son travail de thèse lui a permis de participer à la finale du prix 2020 de la meilleure thèse de l'AMIES (Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société) qui récompense les travaux de mathématiques destinés à l’entreprise.
Au côté de deux autres jeunes docteurs, Mike Pereira a fait une présentation de sa recherche intitulée « Generalized random fields on Riemannian manifolds : theory and practice. Signal and Image processing », diffusée, en direct sur Youtube, le 22 octobre 2020.
Sa thèse CIFRE a été encadrée au Centre de Géosciences de MINES ParisTech par Nicolas Desassis et Hans Wackernagel et elle a été soutenue le 28 novembre 2019. Elle a été réalisée en partenariat avec la société ESTIMAGES.
|
Résumé de cette recherche La géostatistique est la branche des statistiques s’intéressant à la modélisation des phénomènes ancrés dans l’espace au travers de modèles probabilistes. En particulier, le phénomène en question est décrit par un champ aléatoire (généralement gaussien) et les données observées sont considérées comme résultant d’une réalisation particulière de ce champ aléatoire. Afin de faciliter la modélisation et les traitements géostatistiques qui en découlent, il est d’usage de supposer ce champ comme stationnaire et donc de supposer que la structuration spatiale des données se répète dans le domaine d’étude. Cependant, lorsqu’on travaille avec des jeux de données spatialisées complexes, cette hypothèse devient inadaptée. En effet, comment définir cette notion de stationnarité lorsque les données sont indexées sur des domaines non euclidiens (comme des sphères ou autres surfaces lisses) ? Quid également du cas où les données présentent structuration spatiale qui change manifestement d’un endroit à l’autre du domaine d’étude ? En outre, opter pour des modèles plus complexes, lorsque cela est possible, s’accompagne en général d’une augmentation drastique des coûts opérationnels (calcul et mémoire), fermant alors la porte à leur application à de grands jeux de données. Dans ce travail, nous proposons une solution à ces problèmes s’appuyant sur la définition de champs aléatoires généralisés sur des variétés riemanniennes. D’une part, travailler avec des champs aléatoires généralisés permet d’étendre naturellement des travaux récents s’attachant à tirer parti d’une caractérisation des champs aléatoires utilisés en géostatistique comme des solutions d’équations aux dérivées partielles stochastiques. D’autre part, travailler sur des variétés riemanniennes permet à la fois de définir des champs sur des domaines qui ne sont que localement euclidiens, et sur des domaines vus comme déformés localement (ouvrant donc la porte à la prise en compte du cas non stationnaire). Ces champs généralisés sont ensuite discrétisés en utilisant une approche par éléments finis, et nous en donnons une formule analytique pour une large classe de champs généralisés englobant les champs généralement utilisés dans les applications. Enfin, afin de résoudre le problème du passage à l’échelle pour les grands jeux de données, nous proposons des algorithmes inspirés du traitement du signal sur graphe permettant la simulation, la prédiction et l’inférence de ces champs par des approches "matrix-free". |
Soutenance de thèse de Manon LINCKER
Modélisation géochimique des fractionnements isotopiques avec le code de transport réactif Hytec et applications environnementales
Résumé de la thèse en français
L'éventail des processus géochimiques modélisés par les codes de transport réactif a vocation à s'élargir de plus en plus et permet à ces codes de traiter des problématiques de nature différente (stockage de déchets radioactifs, exploitation minière, pollutions, etc.). Cette dernière décennie a vu l'essor de la modélisation des fractionnements isotopiques par les codes de transport réactif. Cette fonctionnalité permet d'ajouter au suivi de réactions géochimiques leur impact sur la composition isotopique des espèces chimiques. Néanmoins, l'hypothèse classiquement utilisée lors de ces modélisations repose sur l'existence d'un isotope majoritaire au sein des isotopes de l'élément d'intérêt. Ces travaux menés à MINES ParisTech contiennent les développements mathématiques réalisés afin de vérifier que la méthodologie reste valide pour un ensemble d'hypothèses moins contraignantes, vérifiées dans la majorité des systèmes naturels. Plusieurs applications ont été réalisées avec Hytec, code de transport réactif développé à MINES ParisTech. La comparaison de résultats dans le cadre d'un benchmark a permis de valider l'emploi de cette méthodologie avec Hytec. Ensuite, un modèle de dégradation et de migration de solvants chlorés dans un système aquifère-aquitard a été mis au point et permet de simuler les signatures isotopiques du carbone et du chlore au sein de ces composés. Les résultats ont montré que le suivi de la composition isotopique des solvants dans l'aquifère peut renseigner sur leur potentielle dégradation dans l'aquitard. Par ailleurs, ces travaux montrent l'importance de la configuration du modèle numérique utilisé ainsi que le potentiel offert par la modélisation des fractionnements isotopiques combinée à la polyvalence d'Hytec.
Résumé de la thèse en anglais
The scope of geochemical processes modeled by reactive transport codes is widening and allows these codes to address different type of problematics (radioactive waste storage, mining, contamination, etc.). The last decade saw the rise of the isotopic fractionation modeling with reactive transport codes. This functionality allows tracing geochemical processes in a more precise way, using geochemical reactions and the isotopic fractionation they induce. However, the traditionally used hypothesis to model isotopic fractionation relies on the existence of a major isotope for the studied element. This work, prepared at MINES ParisTech, contains mathematical developments to support the methodology a set of less constraining hypotheses, easily verified in the majority of natural systems. Several application cases were performed with Hytec, a reactive transport code developed at MINES ParisTech. The comparison of isotopic fractionation simulation results in a benchmark study acts as a validation of this methodology with Hytec. Then, a model of degradation and migration of chlorinated solvents in an aquifer-aquitard system was built step by step. This model allows simulating the isotopic signatures of carbon and chlorine in these components. Results showed that data extracted from the aquifer brings information about the reactivity of the aquitard regarding the solvent degradation. Furthermore, results also highlight the importance of the choice of model parameters and the potential of isotopic fractionation modeling combined to the versatility of Hytec.
Titre anglais : Geochemical modeling of isotopic fractionation: implementation in reactive transport code Hytec and environmental applications
Date de soutenance : mardi 24 novembre 2020 à 14h00
Adresse de soutenance : MINES ParisTech 35 rue Saint Honoré 77300 Fontainebleau – 105
Directeurs de thèse : Vincent LAGNEAU, Sophie GUILLON
 En savoir plus
En savoir plus
